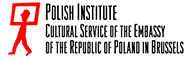Page 3 sur 10
L'Internement
Si nous donnions quelques lei à un simple soldat, il nous laissait aller en ville. Quand il devint évident que nous allions être déménagés vers un nouveau camp, le prêtre vint et nous conseilla : « Les gars, que celui qui veut fuir maintenant fuie, car ce sera peut-être beaucoup plus difficile de partir du nouveau camp. » Le soir, je pris donc la fuite comme prévu avec Pietrek, un copain de Poznań qui avait le même âge que moi. J’avais environ cinquante lei sur moi. J’y allai en premier, comme nous avions convenu que je devais les corrompre pour pouvoir passer. À la garde, ce n’étaient déjà plus de simples soldats, mais une police militaire professionnelle. Comme ils ne voulaient pas nous laisser sortir, je leur donnai d’abord cinq lei, puis dix, puis tout ce qui me restait. « Tiens, tiens, tiens ! » Ils me prirent par le col. L’un d’un côté, l’autre de l’autre côté, et ils m’emmenèrent au poste de garde. Mon copain et moi parlions tout le temps en polonais. À un moment, il s’écria : « Sylwek, va-t’en ! » Je tournai les talons et sauve-qui-peut. Je me précipitai dans l’écurie n°17 qui était vide. Quand je m’y engouffrai, je vis qu’il y avait deux petites pièces des deux côtés de l’entrée de l’écurie et que l’interrupteur se trouvait au milieu de l’écurie, sur un poteau. Je vis donc que je m’étais trompé, que ce n’étais pas mon écurie, mais je ne courus pas plus loin, je filai juste derrière la porte et entrai dans cette petite pièce. Ils coururent allumer la lumière, et moi je sortis pendant ce temps, les mains dans les poches, en sifflant. Tout le corps de garde tirait alors que je m’enfuyais : tous furent alarmés. Ils m’attrapèrent et me conduisirent à un endroit où se trouvaient quarante-neuf autres fugitifs comme moi. Le deuxième jour, quand eut lieu le déménagement, on nous déménagea séparément. Nous étions menés par des soldats avec baïonnette au fusil. Et pendant que nous marchions, je vis le copain qui s’était enfui avec moi : il se promenait dans la rue avec une jeune fille sous le bras. Elle l’avait certainement sorti des rangs de l’armée. Ce fut la dernière fois que je le vis. Ils nous entassèrent dans un wagon rouge à bestiaux. La porte était ouverte, mais les deux côtés étaient gardés par un soldat avec une carabine. À un moment, un des nôtres s’approcha. Il dit qu’un de ses copains était assis dans ce wagon et demanda s’il pouvait lui rendre visite. Le soldat alla chez l’officier Robiński et accepta ensuite de faire entrer le pauvre diable. Il entra, trouva son copain, le vêtit de la capote militaire qu’il venait d’enlever et lui ordonna de sortir. Dix minutes plus tard, il sortit à son tour. Mais le soldat roumain dit : « Quoi ? Il y en a un qui entre et deux qui sortent ? Ce n’est pas possible ! » Alors, ils se mirent à nous compter dans le wagon : « Camarad unu, camarad doi… » Et nous, nous tournions et nous étions toujours de trop. Le train finit par démarrer et nous amena dans une nouvelle localité qui s’appelait Târgu Jiu. Nous nous demandions ce qu’ils avaient maintenant l’intention de faire de nous. Arrivés sur place, ils ouvrirent les wagons et dirent : « Haide, la camarazi! Fuyez chez vos copains ! » Et ils nous laissèrent sortir. Dans le nouveau camp, il y avait des baraquements en bois : quatre fenêtres, une porte et deux cent quarante hommes entassés dans un baraquement. Il n’était pas possible de s’échapper de là. Il y avait du fil barbelé tout autour, puis quatre mètres d’espace vide et encore du fil barbelé. Ils pouvaient y aller en voiture, la garde était montée et les sentinelles s’appelaient toute la journée. « Le poste n°1 est en ordre. » L’autre décrochait : « Le poste n°2 est en ordre. » Ils disaient toujours : « postul 100 este foarte bine! » Et nous, le soir, quand nous sortions, nous criions : « podaj drabinę ! »2 Ils s’indignaient que nous les singions et, nous, nous nous tordions de rire. Dans ce nouveau camp, je me fis un nouveau copain. Il n’y avait pas d’eau courante. Donc, chaque matin, ils l’apportaient dans des grands fûts en béton qui étaient tirés sur un traîneau par des mules dirigées par un Roumain de devant. Je dis à mon pote : « Écoute, moi je me mets dans un fût, toi dans l’autre ! Nous passerons. » Tous les jours pendant une semaine, nous allâmes au poste de garde quand le Roumain rentrait. Nous savions qu’il donnait des documents, signait quelque chose, discutait un instant et partait. Et une fois, tandis qu’il rentrait avec ces fûts vides, nous nous mîmes à l’affût. Moi, je sautai dans l’un, mon copain dans l’autre et nous passâmes. Seulement, comment sortir de ce fût maintenant ? Je penchai la tête et finit par voir mon copain : « Fuyons ! », lui dis-je. Nous sautâmes tous les deux dans le ravin. La fuite n’était planifiée que jusqu’à Bucarest où nous devions arriver par nos propres moyens. Là, nous pouvions aller au Consulat Polonais où nous recevrions des vêtements et un faux passeport pour poursuivre notre fuite. Nous ne pouvions pas acheter de billet pour Bucarest. Des Roumains bienveillants nous dirent d’attendre dans le fossé de l’autre côté de la gare, de sauter dans le train et de donner quelques centimes quand nous nous ferions contrôler, et ce serait en ordre. Nous avions environ trois cents kilomètres à faire jusqu’à la capitale. Nous roulions déjà depuis une bonne heure quand le contrôleur entra dans notre compartiment. Enfin, plutôt deux contrôleurs. Il demanda les billets, donc je fis semblant de les chercher. Il nous regarda et s’exclama : « Polonezi! Des Polonais ! » À l’arrêt suivant, il nous remit au chef du mouvement qui téléphona à la police militaire, et on nous emmena. Après quatorze jours, nous fûmes ramenés au camp d’où nous nous étions enfuis. C’était le pire. À notre retour, les collègues des baraquements se moquaient : « Oh ! Les Français sont de retour ! » Pour la deuxième fois, ma fuite n’avait pas été possible. Les commandants de ces baraquements étaient des officiers roumains. Je leur expliquai : « Je n’étais pas dans l’armée. Je suis un étudiant et j’ai fui la Pologne avec l’armée. » J’avais la preuve qu’en Pologne je n’avais pas encore été appelé dans l’armée et que j’étais parti comme volontaire. Ils me transférèrent dans le camp civil de Braşov. Là, nous étions libres. Chaque semaine, un officier roumain venait contrôler si nous étions tous là. Chaque semaine, et même chaque jour, quelqu’un s’échappait. Ces fuites étaient mieux organisées. L’officier venait toujours accompagné de deux soldats. L’un gardait une porte avec sa carabine, et l’autre la deuxième. Les fenêtres étaient légèrement entrouvertes. Quand l’officier nous appelait, nous montrions une fiche avec notre nom de famille. Ils savaient qui avait fui durant la semaine. Moi, par exemple, j’avais trois fiches à la lettre B. Quand ils nous appelaient, nous entrions l’un après l’autre, cela représentait tout un groupe. Il y en avait toujours un qui était retourné, sur le côté à la fenêtre du baraquement, et quand il revenait, il recevait une deuxième fiche. C’est ainsi que je m’enfuis. De Braşov, j’arrivai à Bucarest et là, comme c’était déjà prévu, je reçus de nouveaux habits et un passeport. Nous devions nous diriger vers Zagreb qui était alors encore en Yougoslavie. Là, nous passâmes quelques huit jours et puis nous partîmes vers la France où j’arrivai précisément le 9 mai 1940. Un jour plus tard, l’Allemagne attaquait la Belgique et la Hollande. Le dernier jour, à la frontière, je me frayai un chemin et là je rejoignis l’armée.
Le 3e Bataillon Blindé avait été créé à cinq ou sept kilomètres d’Orange. Les 1er et 2e bataillons étaient déjà au front. À Orange, il y avait un terrain d’entraînement militaire. Chaque matin, nous partions de Sainte-Cécile pour marcher quelques sept kilomètres au soleil. Puis, nous revenions pour le déjeuner et repartions ensuite vers Orange pour s’entraîner. Nous utilisions des chars R17 qui avaient servi pendant la Première Guerre mondiale. Ils roulaient à une vitesse de sept kilomètres par heure. Nous étions assis par deux à l’intérieur. Il n’y avait aucune radio de sorte que nous communiquions par petits drapeaux. Nous en rigolions. Souvent, nous entrions dans ce char, nous enclenchions la quatrième, nous sortions, il avançait péniblement par lui-même et nous le suivions. En France, la guerre progressait encore plus vite qu’en Pologne. Un jour, l’alarme fut donnée et nous reçûmes l’ordre de partir en train dans le sud, en direction de l’Espagne. Nous arrivâmes à Bayonne, dans un port de pêche. Nous fûmes transportés en canots à moteur sur les Sobieski et Batory, des navires polonais de passagers qui nous attendaient en pleine mer. Ces navires devaient nous conduire en Angleterre. Dans les cabines, il y avait de magnifiques lits superposés et beaucoup d’espace. À peine me fus-je couché cette nuit-là que je dormis tout le voyage. Je naviguais sur le Batory. Le voyage dura vingt-quatre heures. Le navire était tellement chargé que des femmes étaient assises avec des enfants dans les canots de sauvetages qui étaient suspendus sur le côté. Au cas où il y aurait eu une quelconque alarme, ils pouvaient directement mettre les voiles. Notre port en Angleterre était Portsmouth. Là, nous échangeâmes le navire contre un train omnibus. Sur les Îles Britanniques, nous fûmes reçus très humainement. À la gare, nous reçûmes directement deux petits pains et une tasse de thé au lait, ce qui était quelque chose de nouveau pour nous. Personne parmi nous n’avait jamais bu de thé au lait. Ensuite, nous fûmes amenés à Liverpool, à un endroit où il y avait des courses de chevaux. Là, des tentes dressées dans le stade nous attendaient. Du matin au soir, les compagnies allaient l’une après l’autre à la gare. Là, sur une voie latérale, il y avait un train spécial avec des wagons-douches. Nous y entrions à quarante. Chacun devait se déshabiller entièrement. Quand nous étions à l’intérieur de ce wagon, nous pouvions nous asseoir sur des bancs en bois et alors seulement ils lâchaient la vapeur. Je pensais qu’ils voulaient nous achever. Tout le monde suait comme pas possible. Ensuite, ils nous faisaient passer de cette vapeur dans un deuxième wagon pour prendre une douche. Je me sentis renaître. À la sortie, des habits anglais étaient étalés sur des tables, que du neuf. Nous n’arrivions même plus à nous reconnaître. Après trois jours, quand tous se furent lavés, nous reçûmes chacun dix shillings de la part du roi d’Angleterre et on nous laissa aller dans la rue, dans les cafés, etc. Quand je sortais ces dix shillings pour payer quoi que ce fût, les Anglais répondaient : « No pay, no pay! » Ils nous régalaient tous gratuitement. D’Angleterre, ils nous emmenèrent en Écosse. Les 3e et 4e bataillons furent disloqués et divisés entre les 1er et 2e. Ce fut ainsi que je rejoignis le 1er Régiment Blindé. Je stationnai pendant quatre ans sur les Îles Britanniques. Dès le début, nous reçûmes des carabines ordinaires, comme l’infanterie. Nous effectuions un service de mer, défendant les frontières anglaises car, à ce moment-là, les Anglais s’attendaient encore à une invasion allemande. À partir de 1942, ils commencèrent à nous donner des chars afin d’apprendre à les utiliser. Je roulai dans tous les chars anglais qui furent construits pendant cette guerre. Une compagnie comprenait habituellement deux, trois ou quatre chars, et il fallait apprendre. Deux ou trois personnes étaient habituellement envoyées dans le camp anglais pour que quelqu’un les familiarise avec le nouveau matériel. Quand nous revenions, nous devions partager nos connaissances avec toute la compagnie. J’allais souvent à de tels cours, car j’avais vite appris à parler anglais. Les Anglais étaient très gentils avec nous. Ils nous traitaient mieux que leurs propres compatriotes. C’est bien connu : le Polonais combine toujours. Tant d’années ont déjà passé et chaque année on célèbre des événements. En revanche, personne ne se souvient des femmes qui faisaient tant pour soldats en coulisse. Je répète toujours que le plus grand monument qui devrait encore être érigé revient aux femmes. De nombreuses armées de différents pays stationnaient en Angleterre. Le départ en permission était le seul divertissement du soldat. Ils voyageaient dans divers endroits, dans les grandes villes. Moi, je suis allé à Édimbourg. Le soldat allait soit à des soirées dansantes, soit au cinéma ou au café. Nulle part, il ne manquait de femmes, nulle part ! Elles étaient partout, et pas seulement des jeunes, aussi des femmes d’âge moyen. Pour les soldats, c’étaient des occasions de manger moins cher et de coucher moins cher. Nous, les Polonais, tout comme les soldats anglais, nous avions six jours de congé tous les trois mois. Beaucoup d’entre eux restaient dans la caserne, mais moi je partais toujours en congé. C’était le seul divertissement du soldat. Dans les soirées dansantes, on faisait souvent la connaissance de jeunes filles, on échangeait les adresses et on correspondait. L’histoire s’interrompait ou prenait fin devant l’autel.
À propos de la courtoisie des Anglais, je me souviens d’une anecdote. J’étais à Blackpool avec un copain, nous étions assis sur un banc au bord de la mer, quand une famille anglaise s’approcha. Ils nous demandèrent si la place à côté de nous était libre et s’assirent. « Vous êtes des Polonais ? » La dame nous interpella. « C’est pourtant bien écrit », je répondis. Ils nous invitèrent à prendre le thé, juste derrière le coin. Nous allâmes chez eux. Ils nous offrirent aussi des petits gâteaux et nous dirent : « Quand vous aurez un congé ou que vous serez encore ici, venez chez nous. Vous serez toujours les bienvenus ici. »
Quatre ans passèrent ainsi. En 1943, nous organisâmes d’abord cette 1ère Brigade, car ils n’avaient pas suffisamment d’hommes pour former une division. Sikorski partit donc dans le monde entier pour recruter des volontaires. Il le paya de sa vie. De nombreuses recrues furent trouvées parmi les prisonniers pris à l’armée allemande : c’étaient surtout des Silésiens. On leur demandait s’ils voulaient servir dans l’armée polonaise et eux répondaient qu’ils préféraient cela qu’être prisonniers de guerre. C’est ainsi que nous réussîmes à avoir une division au complet. Nous obtînmes également un Sherman, grâce auquel nous pûmes nous exercer. Ensuite, nous fûmes intégrés à la 21e Armée Blindée dont faisaient aussi partie la 4e Division Canadienne et l’infanterie écossaise. Nous partîmes au front en tant que 21e Groupe Blindé. D’Angleterre, nous atterrîmes en Normandie. J’y étais déjà le 30 juillet, mais nous devions attendre sur le côté que toute la division débarquât. Nous entrâmes en action le 8 août. Les combats commencèrent juste derrière la ville de Caen. Les premières troupes avaient débarqué en Normandie le 6 juin et nous, le 8 août, nous n’étions qu’à trente-cinq kilomètres de la mer. Les Allemands opposaient une si terrible résistance. Les Anglais avaient obtenu trop peu de place pour mettre sur pied une grande armée de l’autre côté. Mon opinion est que si la force aérienne britannique n’avait pas eu un tel avantage sur l’Allemagne, cette invasion n’aurait jamais réussi. Les Anglais préparaient cette invasion depuis deux ans. Mais aucune unité ne débarqua là où il était prévu qu’elle débarquât. Le commandant de chaque unité avait une tâche et des points d’observations donnés, mais, quand les soldats étaient dans le bateau, le capitaine du navire s’approchait d’un endroit qui lui convenait et disait : « Bon, vous y êtes. » Et le commandant n’avait rien à dire, car personne n’était arrivé là où il devait arriver. Nous nous dispersâmes. Puis, le 8 août, quand nous entrâmes en action, le 2e Régiment Blindé partit en avant. Quelques vingt-six chars perdirent la moitié de leur matériel.
Le 3e Bataillon Blindé avait été créé à cinq ou sept kilomètres d’Orange. Les 1er et 2e bataillons étaient déjà au front. À Orange, il y avait un terrain d’entraînement militaire. Chaque matin, nous partions de Sainte-Cécile pour marcher quelques sept kilomètres au soleil. Puis, nous revenions pour le déjeuner et repartions ensuite vers Orange pour s’entraîner. Nous utilisions des chars R17 qui avaient servi pendant la Première Guerre mondiale. Ils roulaient à une vitesse de sept kilomètres par heure. Nous étions assis par deux à l’intérieur. Il n’y avait aucune radio de sorte que nous communiquions par petits drapeaux. Nous en rigolions. Souvent, nous entrions dans ce char, nous enclenchions la quatrième, nous sortions, il avançait péniblement par lui-même et nous le suivions. En France, la guerre progressait encore plus vite qu’en Pologne. Un jour, l’alarme fut donnée et nous reçûmes l’ordre de partir en train dans le sud, en direction de l’Espagne. Nous arrivâmes à Bayonne, dans un port de pêche. Nous fûmes transportés en canots à moteur sur les Sobieski et Batory, des navires polonais de passagers qui nous attendaient en pleine mer. Ces navires devaient nous conduire en Angleterre. Dans les cabines, il y avait de magnifiques lits superposés et beaucoup d’espace. À peine me fus-je couché cette nuit-là que je dormis tout le voyage. Je naviguais sur le Batory. Le voyage dura vingt-quatre heures. Le navire était tellement chargé que des femmes étaient assises avec des enfants dans les canots de sauvetages qui étaient suspendus sur le côté. Au cas où il y aurait eu une quelconque alarme, ils pouvaient directement mettre les voiles. Notre port en Angleterre était Portsmouth. Là, nous échangeâmes le navire contre un train omnibus. Sur les Îles Britanniques, nous fûmes reçus très humainement. À la gare, nous reçûmes directement deux petits pains et une tasse de thé au lait, ce qui était quelque chose de nouveau pour nous. Personne parmi nous n’avait jamais bu de thé au lait. Ensuite, nous fûmes amenés à Liverpool, à un endroit où il y avait des courses de chevaux. Là, des tentes dressées dans le stade nous attendaient. Du matin au soir, les compagnies allaient l’une après l’autre à la gare. Là, sur une voie latérale, il y avait un train spécial avec des wagons-douches. Nous y entrions à quarante. Chacun devait se déshabiller entièrement. Quand nous étions à l’intérieur de ce wagon, nous pouvions nous asseoir sur des bancs en bois et alors seulement ils lâchaient la vapeur. Je pensais qu’ils voulaient nous achever. Tout le monde suait comme pas possible. Ensuite, ils nous faisaient passer de cette vapeur dans un deuxième wagon pour prendre une douche. Je me sentis renaître. À la sortie, des habits anglais étaient étalés sur des tables, que du neuf. Nous n’arrivions même plus à nous reconnaître. Après trois jours, quand tous se furent lavés, nous reçûmes chacun dix shillings de la part du roi d’Angleterre et on nous laissa aller dans la rue, dans les cafés, etc. Quand je sortais ces dix shillings pour payer quoi que ce fût, les Anglais répondaient : « No pay, no pay! » Ils nous régalaient tous gratuitement. D’Angleterre, ils nous emmenèrent en Écosse. Les 3e et 4e bataillons furent disloqués et divisés entre les 1er et 2e. Ce fut ainsi que je rejoignis le 1er Régiment Blindé. Je stationnai pendant quatre ans sur les Îles Britanniques. Dès le début, nous reçûmes des carabines ordinaires, comme l’infanterie. Nous effectuions un service de mer, défendant les frontières anglaises car, à ce moment-là, les Anglais s’attendaient encore à une invasion allemande. À partir de 1942, ils commencèrent à nous donner des chars afin d’apprendre à les utiliser. Je roulai dans tous les chars anglais qui furent construits pendant cette guerre. Une compagnie comprenait habituellement deux, trois ou quatre chars, et il fallait apprendre. Deux ou trois personnes étaient habituellement envoyées dans le camp anglais pour que quelqu’un les familiarise avec le nouveau matériel. Quand nous revenions, nous devions partager nos connaissances avec toute la compagnie. J’allais souvent à de tels cours, car j’avais vite appris à parler anglais. Les Anglais étaient très gentils avec nous. Ils nous traitaient mieux que leurs propres compatriotes. C’est bien connu : le Polonais combine toujours. Tant d’années ont déjà passé et chaque année on célèbre des événements. En revanche, personne ne se souvient des femmes qui faisaient tant pour soldats en coulisse. Je répète toujours que le plus grand monument qui devrait encore être érigé revient aux femmes. De nombreuses armées de différents pays stationnaient en Angleterre. Le départ en permission était le seul divertissement du soldat. Ils voyageaient dans divers endroits, dans les grandes villes. Moi, je suis allé à Édimbourg. Le soldat allait soit à des soirées dansantes, soit au cinéma ou au café. Nulle part, il ne manquait de femmes, nulle part ! Elles étaient partout, et pas seulement des jeunes, aussi des femmes d’âge moyen. Pour les soldats, c’étaient des occasions de manger moins cher et de coucher moins cher. Nous, les Polonais, tout comme les soldats anglais, nous avions six jours de congé tous les trois mois. Beaucoup d’entre eux restaient dans la caserne, mais moi je partais toujours en congé. C’était le seul divertissement du soldat. Dans les soirées dansantes, on faisait souvent la connaissance de jeunes filles, on échangeait les adresses et on correspondait. L’histoire s’interrompait ou prenait fin devant l’autel.
À propos de la courtoisie des Anglais, je me souviens d’une anecdote. J’étais à Blackpool avec un copain, nous étions assis sur un banc au bord de la mer, quand une famille anglaise s’approcha. Ils nous demandèrent si la place à côté de nous était libre et s’assirent. « Vous êtes des Polonais ? » La dame nous interpella. « C’est pourtant bien écrit », je répondis. Ils nous invitèrent à prendre le thé, juste derrière le coin. Nous allâmes chez eux. Ils nous offrirent aussi des petits gâteaux et nous dirent : « Quand vous aurez un congé ou que vous serez encore ici, venez chez nous. Vous serez toujours les bienvenus ici. »
Quatre ans passèrent ainsi. En 1943, nous organisâmes d’abord cette 1ère Brigade, car ils n’avaient pas suffisamment d’hommes pour former une division. Sikorski partit donc dans le monde entier pour recruter des volontaires. Il le paya de sa vie. De nombreuses recrues furent trouvées parmi les prisonniers pris à l’armée allemande : c’étaient surtout des Silésiens. On leur demandait s’ils voulaient servir dans l’armée polonaise et eux répondaient qu’ils préféraient cela qu’être prisonniers de guerre. C’est ainsi que nous réussîmes à avoir une division au complet. Nous obtînmes également un Sherman, grâce auquel nous pûmes nous exercer. Ensuite, nous fûmes intégrés à la 21e Armée Blindée dont faisaient aussi partie la 4e Division Canadienne et l’infanterie écossaise. Nous partîmes au front en tant que 21e Groupe Blindé. D’Angleterre, nous atterrîmes en Normandie. J’y étais déjà le 30 juillet, mais nous devions attendre sur le côté que toute la division débarquât. Nous entrâmes en action le 8 août. Les combats commencèrent juste derrière la ville de Caen. Les premières troupes avaient débarqué en Normandie le 6 juin et nous, le 8 août, nous n’étions qu’à trente-cinq kilomètres de la mer. Les Allemands opposaient une si terrible résistance. Les Anglais avaient obtenu trop peu de place pour mettre sur pied une grande armée de l’autre côté. Mon opinion est que si la force aérienne britannique n’avait pas eu un tel avantage sur l’Allemagne, cette invasion n’aurait jamais réussi. Les Anglais préparaient cette invasion depuis deux ans. Mais aucune unité ne débarqua là où il était prévu qu’elle débarquât. Le commandant de chaque unité avait une tâche et des points d’observations donnés, mais, quand les soldats étaient dans le bateau, le capitaine du navire s’approchait d’un endroit qui lui convenait et disait : « Bon, vous y êtes. » Et le commandant n’avait rien à dire, car personne n’était arrivé là où il devait arriver. Nous nous dispersâmes. Puis, le 8 août, quand nous entrâmes en action, le 2e Régiment Blindé partit en avant. Quelques vingt-six chars perdirent la moitié de leur matériel.
2 Signifiant littéralement « Donne l’échelle ! », cette phrase polonaise est phonétiquement proche de l’expression roumaine « post ul 100 este foarte bine! ».