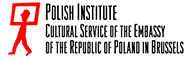Page 5 sur 10
La guerre dans le Blindés
Quand nous chargions et que nous étions assis dans le char, c’était joyeux, nous riions bien. Mais, dès qu’il y avait un quelconque danger, chacun regardait attentivement dans sa direction. Tout le monde avait peur car nul ne savait s’il allait encore vivre cinq minutes. Tout le monde n’a pas le caractère pour survivre. Le plus important était d’avoir des bons copains dans l’équipage. Quand je fus blessé, ils voulurent m’emmener à l’hôpital, mais je refusai. Je ne voulais pas être affecté après à un autre équipage. Nous étions en phase : chacun connaissait son travail, pouvait compléter les munitions, nettoyer le canon et trouver un endroit pour dormir. Quand nous avions ces bâches qui servaient à recouvrir le char, nous pouvions nous fabriquer une tente. Néanmoins, quand l’ennemi était trop près ou qu’il tirait de trop, nous devions rester dans le char. Parfois, nous restions assis dedans pendant toute la journée. Et quand on nous disait par radio de ne pas sortir, nous devions y dormir. Ce n’était pas facile. Parfois, il y avait une brèche et nous sortions dormir sous le char pour un peu s’étirer. Souvent, je me disais que j’aurais donné n’importe quoi pour me coucher dans la rue, même avec une pierre sous la tête, pourvu seulement que je pus m’étendre et dormir. Il arrivait que nous ne changions pas de vêtements pendant des semaines. Chez nous, les rôles étaient partagés. Par exemple, le principal tireur au canon avait été scout dans sa jeunesse. C’est lui qui nous préparait à manger. Il faisait toujours en sorte que nous mangions quelque chose de chaud le soir. Il partageait les conserves anglaises en cinq et les faisait un peu frire avec un oignon. Il essayait toujours que cela eût du goût. Les deux conducteurs s’occupaient du char de manière à ce qu’il fût toujours prêt à partir le lendemain. L’opérateur radio prenait soin des réserves de munitions. Quand nous en avions épuisé entre vingt et trente, il fallait nettoyer le canon. C’est lui qui s’occupait de cela. Bien qu’il fût officier, Poniatowski restait avec nous. Quand l’occasion se présentait, nous faisions toujours en sorte que le commandant pût dormir dans un appartement. Mais il restait toujours avec nous. Quand nous nous arrêtâmes à Saint-Gilles-Waes, nous dormîmes le premier jour dans une entrée dont le plafond était recouvert de peaux de lapin qui séchaient. Il y avait une petite chambre pour Poniatowski. Alors que nous étions assis tous ensemble le soir, le commandant de la compagnie arriva et s’exclama : « Vous avez pourtant un endroit pour dormir chez ces gens. » Sur ce, Poniatowski répliqua : « J’y suis allé et j’ai vu que ces gens avaient trop peu de place pour eux-mêmes, alors je dors ici avec les soldats. » Une journée ensoleillée, nous nous reposions après le repas, les bérets sur les yeux, et, lui, il se lavait dans cette eau froide. Le capitaine arriva pour contrôler et l’interrogea : « Que faites-vous ? » Sur ce, il répondit calmement : « Vous ne le voyez pas ? » Il ne voulait jamais profiter du confort qui lui revenait. Chaque matin, il allait à la réunion préparatoire pour s’informer des tâches qu’il devait ensuite nous transmettre. Alors qu’il y allait, nous lui préparions du café pendant ce temps. Quand il revenait, il criait : « Ennemi à gauche, ennemi devant. Le café est prêt ? » C’était un chouette gars. Dommage que nous l’ayons perdu. C’était le 22 décembre, quand nous stationnions dans le village hollandais de Sint-Phillipsland pendant l’offensive de von Rundstedt. Les Anglais et les Américains se préparaient à célébrer Noël et le Nouvel An, mais les Allemands firent encore une incursion à leur encontre pour reprendre Anvers. Il y avait justement du brouillard, de la neige et il faisait froid à ce moment-là. Ils profitèrent du fait que les avions ne pouvaient pas voler. Seulement, cela ne leur réussit pas. Il y avait à Sint-Philippsland une tour de château d’eau que les Allemands devaient contrôler, ayant remarqué que des observateurs anglais y étaient postés. Ils décidèrent de faire sauter cette tour. Toutefois, pour tromper tout le monde, ils préparèrent d’abord une attaque contre nous. Nous étions à six chars, placés à l’avant de la compagnie. Sur la digue, au bord de la mer, la garde était tenue par des volontaires hollandais de l’armée clandestine qui s’enfuirent tous quand ils virent les bateaux s’approcher. Les Allemands étaient habillés en blanc. Poniatowski était justement chez les Anglais. Quand il entendit tirer, il arriva sur-le-champ en voiture blindée. En sortant de la voiture, il dit : « Oh, oh ! Cela faisait longtemps que nous n’avions plus entendu de tirs ! » Je lui ordonnai de rentrer dans le char. Il était onze heures du soir. Et lui, plutôt que d’entrer dans l’appareil et de s’enfermer, il baissa les jambes et s’assit sur la tourelle. J’étais justement à l’entrée. Il me dit que je n’étais pas bien positionné. Alors, je lui demandai comment je devais me positionner. Il commença à me donner des conseils par radio sur la manière dont je devais me déplacer : à gauche, à droite, en arrière. « Ratatatata ! » Il en partit toute une série. C’était comme si quelqu’un avait pris des pierres en main et les avait jetées toutes en un coup. Il fut touché à la tête. Il tomba de la tour. Il faisait noir. Il n’y avait pas de contact radio. D’ailleurs, les compagnies étaient trop loin. Je devais prendre une décision et les deux nouveaux gars que j’avais reçus tremblaient de peur. Dans le char, nous avions un passage par lequel nous pouvions rejoindre la tourelle. Józek y parvint et dit : « Sylwek, reculons car il vit encore, il me serre la main. » Il ne savait pas à quel point Poniatowski était blessé. Nous allâmes au village de Stinberg, à une quinzaine kilomètres de l’accident. Je me dépêchai comme je pouvais avec ce char. Là, les infirmiers le tirèrent et dirent : « Oooh ! Dans deux semaines, il sera de retour auprès de vous. » Mais il mourut déjà dans l’ambulance. Le jour suivant, nous allâmes nettoyer le char. Il y avait son béret, un peu de cervelle et, dans son béret, la balle qui avait transpercé sa tête. Quand sa famille de Paris apprit qu’il était mort, sa maman voulut que ceux qui avaient été avec lui dans le char amenassent son corps. Nous passâmes la nuit dans sa maison familiale. La famille était manifestement riche. Il y avait trois ou quatre serviteurs et chacun avait sa voiture. Toutefois, Poniatowski ne le montrait pas. Il ne parlait jamais de lui. Je savais qu’il avait fini une école d’aspirants chez les Anglais. Il parlait bien polonais, mais lentement et il devait réfléchir. Il traduisait sûrement du français. Il avait probablement appris le polonais dans une école, car il avait une bonne prononciation. Nous fûmes très éprouvés par sa mort. S’il n’y avait pas eu cette offensive de von Rundstedt, nous n’aurions certainement pas repris le combat, car nous savions déjà que nous nous battions pour rien. Nous le savions car les frontières polonaises avaient déjà été définies à Yalta. Nous savions qu’il n’y avait pas de retour pour nous. Nous avions libéré les Français, les Belges, les Hollandais, mais nous n’étions pas capables de nous libérer nous-mêmes. Chacun changea de nationalité. Les Anglais voulaient que le plus possible de Polonais rentrât en Pologne. Ils n’étaient plus nécessaires. Des officiers polonais vinrent donc nous trouver pour demander aux soldats : « Que ceux qui veulent rentrer fassent trois pas en avant. » Personne ne sortit du rang. Pourquoi ? Les Américains n’avaient attendu que deux jours aux portes de Paris avant que les Français n’entrassent dans la capitale, car de Gaulle avait dit : « Mon armée entrera la première dans Paris. » En Belgique, ce fut la même chose quand la brigade belge entra dans Bruxelles sous le commandement du général Piron. Et nous, il ne nous était permis que de rentrer individuellement, comme des fuyards. Et pas directement à la maison, mais d’abord dans un camp. Une question se pose : « Pour quelle raison t’es-tu retrouvé en Angleterre ? » Ceux qui servaient dans l’armée allemande n’eurent pas tant de problèmes. Mais nous, nous avions quitté la Pologne pour la Roumanie en 1939. Si je n’avais pas fui à ce moment-là, j’aurais certainement fini entre les mains des Russes. Ils nous dirent que celui qui ne rentrerait pas au pays dans un délai donné serait privé de sa nationalité. D’un côté, c’était même plus confortable pour nous, car il nous était plus facile de demander la nationalité belge si nous avions perdu la nationalité polonaise. Autrement, nous aurions dû d’abord demander l’autorisation aux autorités polonaises.