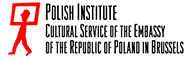Strona 4 z 10
Le champ de bataille
Un jour plus tard, c’était nous – le 1er Régiment – qui étions en avant. Nous chargeâmes pendant toute la journée. Les Allemands reculèrent. Nous étions chargés de monter sur la colline 111 qui était dessinée sur notre carte. Nous ne fûmes confrontés à la résistance allemande que quand nous fûmes déjà tout près. Nous avancions à neuf chars groupés en trois pelotons. Les Allemands étaient tellement bien camouflés que ne voyions pas d’où ils tiraient. Je reçus un premier coup sur le côté du char, à quelques vingt-cinq centimètres de ma tête. Je dis toujours que je remercie cet Allemand d’avoir si bien visé. Et donc il avait tiré sur mon Sherman. La balle d’environ dix centimètres de diamètre s’était enfoncée dans le fer du char comme une cuillère dans du beurre à une profondeur de trente-cinq centimètres. Mon périscope était cassé, je ne pouvais plus rien voir. L’opérateur radio avait la main sur la culasse du canon et me criait : « Sylwek, va dans la forêt ! » Moi, je ne savais pas où était la forêt, puisque je ne voyais rien. J’ouvris la trappe et quand je me penchai, à ce moment « fschhh ! », une deuxième fois. Précisément à l’endroit où le canon avait bougé. Nous n’attendîmes pas la troisième balle, nous sortîmes tous les cinq du char. Et à ce moment-là, les huit chars prirent feu comme des bougies. Tous ceux qui réussirent à se sauver commencèrent à s’enfuir. Mon char continuait à descendre la colline.
Le soir tomba, nous sortîmes discrètement de la forêt et nous commençâmes à rechercher notre Sherman. Nous ne savions pas si les Allemands étaient toujours là ou pas. Nous sortîmes les revolvers et nous faufilâmes en silence. Il n’y avait personne. « Où allons-nous maintenant ? » Le commandant répliqua : « En avant ! » Le tireur de canon dit : « Tu es fou ! Personne n’est allé aussi loin que nous ! » Et ils commencèrent à se disputer. Finalement, nous vîmes que quelqu’un tirait des fusées blanches derrière nous. C’étaient les nôtres, donc nous fîmes demi-tour. Le deuxième jour, nous reçûmes un nouveau char. Nous changeâmes aussi le commandant de notre char. À sa place vint le prince Poniatowski, le sous-lieutenant Poniatowski. Mon deuxième conducteur avait, lui aussi, des problèmes. Tout au long de l’incident, il avait tremblé comme s’il avait attrapé la fièvre jaune. « Sylwek, je déserte », m’avait-il dit pendant la nuit. Je lui avais répliqué : « Tu as perdu la tête ? Tu vas te prendre illico une balle dans la tête ! » J’allai chez le capitaine et lui expliquai la situation. Mon conducteur fut finalement engagé dans une compagnie professionnelle. Moi, je reçus en retour le copain avec lequel j’avais servi en Écosse. Lui, il était petit, plus petit que moi d’une tête entière, et tellement hardi que, s’il était convaincu d’avoir raison, il était capable de se disputer, même avec un général. D’ailleurs, en Écosse, il s’était disputé avec le chef qui l’avait déplacé dans la compagnie de réserve. On leur demanda donc qui de là-bas était prêt à aller au front en tant que conducteur. Mon copain – il s’appelait Józef Piskorek – demanda : « Chez qui ? » On lui répondit : « Chez Bardziński. » Ainsi, nous passèrent presque tout le temps de la guerre ensemble. Sur le front, les Américains marchaient d’un côté, les Anglais de l’autre, et les Allemands se trouvaient dans une poche. Un général canadien avait élaboré une stratégie que nous ne découvrîmes qu’après les événements, car à cette époque tout était gardé secret et le soldat ne savait que ce qu’il lui était permis de savoir. Nous fûmes chargés d’atteindre le mont Ormel qui était la colline 262 d’après notre carte. Et ce général dit à notre lieutenant : « Regarde bien la carte quand tu monteras sur cette massue » – car la colline y faisait penser par sa forme sur la carte –, « d’en haut tu verras alors tous les chemins par lesquels ils peuvent s’échapper de cette poche ». En discutant de cette façon, ils devaient empêcher les Allemands qui écoutaient de comprendre ce dont il était question. Les soldats furent chargés de rouler sans lumière, de ne pas utiliser la radio et d’aller en haut du mont 262. Nous devions fendre la ligne allemande sur huit kilomètres. Toute la colonne allemande était sur le côté de la route. La route n’était pas large, donc nos soldats leur demandèrent s’ils pouvaient passer. Ils nous laissèrent passer. Nous étions perplexes, nous pensions qu’ils nous attendaient quelque part, que c’était un piège. Et sur cette colline, mon 1er Régiment était suivi par les Canadiens et le 2e Régiment qui devait se diriger du côté de Chambois mais qui arriva à Champeaux à la place. À un certain moment, le contact avec le 2e Régiment fut rompu, ils ne réapparurent que le deuxième jour. Sur la colline, nous restâmes trois jours et trois nuits. Les Allemands nous assaillaient de toutes parts. Notre approvisionnement ne pouvait plus nous parvenir, ils nous parachutèrent du carburant et de l’eau par avion. Le front était très petit, donc une partie de ces provisions alla aux Allemands. Après trois jours, nous réussîmes à fermer cette poche. La nuit, de nombreux Allemands parvinrent à se dégager, mais nous les firent prisonniers pour la plupart. Le premier jour, nous eûmes plus de cinq mille prisonniers allemands et nous ne savions pas quoi en faire. Ils étaient assis, rabougris et épuisés comme des poules malades. Heureusement, nous réussîmes à établir un contact avec les Américains et nous leur remîmes ces prisonniers. Après trois jours, les Canadiens arrivèrent sur la colline. Ce fut notre plus grande victoire. Montgomery en personne dit que les Allemands étaient assis dans une bouteille et que les Polonais étaient à un pas de celle-ci. Mais on ne trouve jamais rien à ce sujet dans les livres. Je ne dis pas que la guerre s’est terminée deux ou trois jours plus tôt grâce aux Polonais. Comme une fois j’étais à l’anniversaire du débarquement en Normandie, j’achetai un livre dont l’auteur était un sergent anglais. Il décrivait les batailles en Normandie. Je l’achetai, curieux de savoir ce que l’on écrivait sur les Polonais. Pas un mot. Sur la dernière page du livre, tous les commandants étaient écrits : il n’y en avait aucun des nôtres. Était-ce sa faute ? C’était plutôt la nôtre ! Ce sont les Polonais qui doivent dire comment cela s’est vraiment passé.
En Allemagne, quand nous arrivâmes à Wilhelmshaven, j’eus plus de chance que de raison. Je roulais toujours en première ligne. Seulement, j’avais été une fois blessé quand j’avais sauté du char au moment où il avait heurté le canon. J’eus des éclats dans la tête et mon copain eut le bras cassé. Je fus une fois blessé et ne perdis qu’un seul char. Quand nous arrivâmes à Wilhelmshaven, la guerre était déjà finie là-bas. Ce jour-là, les Anglais et les Écossais étaient tout fous, ils jetaient leurs casquettes en l’air. Et nous ? Nous, nous savions déjà que nous avions versé notre sang à vil prix, à prix plus bas que celui de l’eau. Notre commandement déclara : « Nous avons commencé les premier et nous voulons terminer les derniers. » Et plus tard, depuis l’Allemagne, nous fûmes autorisés à rentrer en Pologne, mais un à un, comme des fuyards. Notre gouvernement qui siégeait à Londres avait fui la Pologne, tout comme nous. Nous nous étions battus sous ce gouvernement. La Pologne ne voulait pas discuter avec eux, ni avec Sikorski, ni avec Maczek. Par conséquent, tous ceux parmi nous qui le pouvaient restaient à l’étranger. Nous effectuâmes encore un service de deux ans en Allemagne pour les Anglais dans la British Army of Rain. Quiconque voulait être dispensé de l’armée le pouvait, mais il devait prouver où il allait. Plusieurs d’entre nous retournèrent en Angleterre après deux ans, les autres se rendirent en Hollande qui était plus proche. Moi, je restai à Saint-Gilles-Waes, un village que nous avions libéré sur la route d’Hulst et d’Axel. Nous étions dans l’appartement de braves gens. C’était déjà le mois de novembre, le temps de se reposer quelques jours après les combats. Les chars étaient restés dans les prés. Notre commandement avait accepté que les soldats fussent installés chez des civils. Je vécus dans une famille dans laquelle je rencontrai ma future femme, comme il s’avéra plus tard. Ce fut aussi toute une aventure. Ma femme avait un frère cadet qui restait seul à la maison quand leurs parents partaient. Le secrétaire communal vint lui demander : « Combien de soldats vous pouvez accueillir ici ? » Il répondit : « Il y a ces deux pièces. » Quand le père et la mère furent de retour à la maison, le petit dit : « Vous devez préparer ces deux pièces car treize soldats viennent chez nous. » Comme Paris avait déjà été libérée, notre commandant Poniatowski y alla en permission. Nous restâmes entre quatre et cinq jours chez ces gens, jusqu’à ce que nous reçussions l’ordre de rentrer. Poniatowski n’était toujours pas là. En quittant le village, le père de ma femme, qui avait servi pendant la Première Guerre mondiale, nous marqua chacun d’une croix et dit : « Nul d’entre vous ne mourra jamais plus. » Et c’est ce qui arriva. Poniatowski n’avait pas reçu cette petite croix et il connut une mort tragique. Était-ce un hasard ?
Le soir tomba, nous sortîmes discrètement de la forêt et nous commençâmes à rechercher notre Sherman. Nous ne savions pas si les Allemands étaient toujours là ou pas. Nous sortîmes les revolvers et nous faufilâmes en silence. Il n’y avait personne. « Où allons-nous maintenant ? » Le commandant répliqua : « En avant ! » Le tireur de canon dit : « Tu es fou ! Personne n’est allé aussi loin que nous ! » Et ils commencèrent à se disputer. Finalement, nous vîmes que quelqu’un tirait des fusées blanches derrière nous. C’étaient les nôtres, donc nous fîmes demi-tour. Le deuxième jour, nous reçûmes un nouveau char. Nous changeâmes aussi le commandant de notre char. À sa place vint le prince Poniatowski, le sous-lieutenant Poniatowski. Mon deuxième conducteur avait, lui aussi, des problèmes. Tout au long de l’incident, il avait tremblé comme s’il avait attrapé la fièvre jaune. « Sylwek, je déserte », m’avait-il dit pendant la nuit. Je lui avais répliqué : « Tu as perdu la tête ? Tu vas te prendre illico une balle dans la tête ! » J’allai chez le capitaine et lui expliquai la situation. Mon conducteur fut finalement engagé dans une compagnie professionnelle. Moi, je reçus en retour le copain avec lequel j’avais servi en Écosse. Lui, il était petit, plus petit que moi d’une tête entière, et tellement hardi que, s’il était convaincu d’avoir raison, il était capable de se disputer, même avec un général. D’ailleurs, en Écosse, il s’était disputé avec le chef qui l’avait déplacé dans la compagnie de réserve. On leur demanda donc qui de là-bas était prêt à aller au front en tant que conducteur. Mon copain – il s’appelait Józef Piskorek – demanda : « Chez qui ? » On lui répondit : « Chez Bardziński. » Ainsi, nous passèrent presque tout le temps de la guerre ensemble. Sur le front, les Américains marchaient d’un côté, les Anglais de l’autre, et les Allemands se trouvaient dans une poche. Un général canadien avait élaboré une stratégie que nous ne découvrîmes qu’après les événements, car à cette époque tout était gardé secret et le soldat ne savait que ce qu’il lui était permis de savoir. Nous fûmes chargés d’atteindre le mont Ormel qui était la colline 262 d’après notre carte. Et ce général dit à notre lieutenant : « Regarde bien la carte quand tu monteras sur cette massue » – car la colline y faisait penser par sa forme sur la carte –, « d’en haut tu verras alors tous les chemins par lesquels ils peuvent s’échapper de cette poche ». En discutant de cette façon, ils devaient empêcher les Allemands qui écoutaient de comprendre ce dont il était question. Les soldats furent chargés de rouler sans lumière, de ne pas utiliser la radio et d’aller en haut du mont 262. Nous devions fendre la ligne allemande sur huit kilomètres. Toute la colonne allemande était sur le côté de la route. La route n’était pas large, donc nos soldats leur demandèrent s’ils pouvaient passer. Ils nous laissèrent passer. Nous étions perplexes, nous pensions qu’ils nous attendaient quelque part, que c’était un piège. Et sur cette colline, mon 1er Régiment était suivi par les Canadiens et le 2e Régiment qui devait se diriger du côté de Chambois mais qui arriva à Champeaux à la place. À un certain moment, le contact avec le 2e Régiment fut rompu, ils ne réapparurent que le deuxième jour. Sur la colline, nous restâmes trois jours et trois nuits. Les Allemands nous assaillaient de toutes parts. Notre approvisionnement ne pouvait plus nous parvenir, ils nous parachutèrent du carburant et de l’eau par avion. Le front était très petit, donc une partie de ces provisions alla aux Allemands. Après trois jours, nous réussîmes à fermer cette poche. La nuit, de nombreux Allemands parvinrent à se dégager, mais nous les firent prisonniers pour la plupart. Le premier jour, nous eûmes plus de cinq mille prisonniers allemands et nous ne savions pas quoi en faire. Ils étaient assis, rabougris et épuisés comme des poules malades. Heureusement, nous réussîmes à établir un contact avec les Américains et nous leur remîmes ces prisonniers. Après trois jours, les Canadiens arrivèrent sur la colline. Ce fut notre plus grande victoire. Montgomery en personne dit que les Allemands étaient assis dans une bouteille et que les Polonais étaient à un pas de celle-ci. Mais on ne trouve jamais rien à ce sujet dans les livres. Je ne dis pas que la guerre s’est terminée deux ou trois jours plus tôt grâce aux Polonais. Comme une fois j’étais à l’anniversaire du débarquement en Normandie, j’achetai un livre dont l’auteur était un sergent anglais. Il décrivait les batailles en Normandie. Je l’achetai, curieux de savoir ce que l’on écrivait sur les Polonais. Pas un mot. Sur la dernière page du livre, tous les commandants étaient écrits : il n’y en avait aucun des nôtres. Était-ce sa faute ? C’était plutôt la nôtre ! Ce sont les Polonais qui doivent dire comment cela s’est vraiment passé.
En Allemagne, quand nous arrivâmes à Wilhelmshaven, j’eus plus de chance que de raison. Je roulais toujours en première ligne. Seulement, j’avais été une fois blessé quand j’avais sauté du char au moment où il avait heurté le canon. J’eus des éclats dans la tête et mon copain eut le bras cassé. Je fus une fois blessé et ne perdis qu’un seul char. Quand nous arrivâmes à Wilhelmshaven, la guerre était déjà finie là-bas. Ce jour-là, les Anglais et les Écossais étaient tout fous, ils jetaient leurs casquettes en l’air. Et nous ? Nous, nous savions déjà que nous avions versé notre sang à vil prix, à prix plus bas que celui de l’eau. Notre commandement déclara : « Nous avons commencé les premier et nous voulons terminer les derniers. » Et plus tard, depuis l’Allemagne, nous fûmes autorisés à rentrer en Pologne, mais un à un, comme des fuyards. Notre gouvernement qui siégeait à Londres avait fui la Pologne, tout comme nous. Nous nous étions battus sous ce gouvernement. La Pologne ne voulait pas discuter avec eux, ni avec Sikorski, ni avec Maczek. Par conséquent, tous ceux parmi nous qui le pouvaient restaient à l’étranger. Nous effectuâmes encore un service de deux ans en Allemagne pour les Anglais dans la British Army of Rain. Quiconque voulait être dispensé de l’armée le pouvait, mais il devait prouver où il allait. Plusieurs d’entre nous retournèrent en Angleterre après deux ans, les autres se rendirent en Hollande qui était plus proche. Moi, je restai à Saint-Gilles-Waes, un village que nous avions libéré sur la route d’Hulst et d’Axel. Nous étions dans l’appartement de braves gens. C’était déjà le mois de novembre, le temps de se reposer quelques jours après les combats. Les chars étaient restés dans les prés. Notre commandement avait accepté que les soldats fussent installés chez des civils. Je vécus dans une famille dans laquelle je rencontrai ma future femme, comme il s’avéra plus tard. Ce fut aussi toute une aventure. Ma femme avait un frère cadet qui restait seul à la maison quand leurs parents partaient. Le secrétaire communal vint lui demander : « Combien de soldats vous pouvez accueillir ici ? » Il répondit : « Il y a ces deux pièces. » Quand le père et la mère furent de retour à la maison, le petit dit : « Vous devez préparer ces deux pièces car treize soldats viennent chez nous. » Comme Paris avait déjà été libérée, notre commandant Poniatowski y alla en permission. Nous restâmes entre quatre et cinq jours chez ces gens, jusqu’à ce que nous reçussions l’ordre de rentrer. Poniatowski n’était toujours pas là. En quittant le village, le père de ma femme, qui avait servi pendant la Première Guerre mondiale, nous marqua chacun d’une croix et dit : « Nul d’entre vous ne mourra jamais plus. » Et c’est ce qui arriva. Poniatowski n’avait pas reçu cette petite croix et il connut une mort tragique. Était-ce un hasard ?